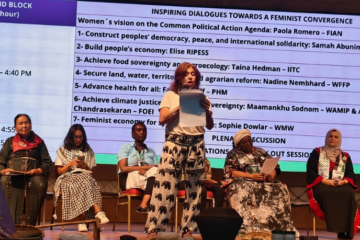Depuis des années, le mouvement féministe dénonce l’alliance entre autoritarismes et intérêts capitalistes, en exposant les attaques contre les droits des femmes comme une stratégie articulée. La militarisation accrue, l’expulsion de communautés de leurs territoires, l’absence de réglementation du pouvoir des entreprises et les crises environnementales mettent en péril non seulement les droits des peuples et des femmes, mais aussi la sécurité des personnes qui s’organisent pour les défendre.
Les femmes en mouvement ont joué un rôle fondamental dans la résistance à l’offensive brutale contre les corps, les territoires et les démocraties. Elles apparaissent comme des voix essentielles dans des contextes marqués par des persécutions systématiques et de graves violations du droit international. Dans de nombreux endroits, tels que le Bangladesh et le Sri Lanka, ce sont elles qui dirigent les mouvements sociaux transformateurs, qui exigent des changements profonds dans leurs pays et qui, de ce fait, sont confrontées aux risques de celles qui sont en première ligne. Au Bangladesh, l’étudiante Maliha Namla a déclaré : « C’est grâce aux femmes que ce mouvement est devenu une révolution populaire ».
Dans le même contexte, des étudiants, hommes et femmes, ont été attaqués dans leurs dortoirs par des membres de la Ligue Chatra du Bangladesh, liée au parti de l’ancienne première ministre. Il est important de noter que dans les contextes où les femmes sont les cibles prioritaires de la violence, ce sont précisément elles qui jouent un rôle central dans la réponse aux crises auxquelles sont confrontées leurs communautés, comme c’est le cas en République démocratique du Congo et au Soudan. Les femmes sont victimes d’agressions verbales et physiques, de criminalisation et même de meurtre.
Du Myanmar au Cachemire, de la Palestine à la Colombie, ce sont les femmes qui prennent soin de leurs communautés, garantissant l’accès aux besoins fondamentaux et poursuivant la lutte pour la justice, l’égalité et la paix. Elles font donc souvent face à des grands risques
- Un regard sur les données
Deuxième enquête de l’organisation irlandaise Front Line Defenders, les personnes qui défendent les droits des femmes étaient le groupe le plus menacé au niveau mondial en 2024 et le deuxième en 2023, représentant 12 % des violations documentées en 2024 et 10 % en 2023.
Les organisations et les personnes qui défendent les droits des femmes ont été la cible de diverses violations : menaces (21,4 %), arrestations arbitraires (19,5 %), actions en justice (7,6 %), interrogatoires (6,5 %), menaces de mort et autres formes d’intimidation (5,3 %). Dans un contexte de recul des droits des femmes au niveau mondial, les femmes continuent d’être en première ligne, et donc, dans la ligne de mire.
Les cinq violations les plus documentées à l’encontre de tous les groupes de défense des droits sont les suivantes : arrestations/criminalisations, menaces, actions en justice, menaces de mort et surveillance. Bien que les proportions de chacune de ces menaces ne varient pas de manière significative entre les femmes et les hommes, chacune d’entre elles les affecte d’une manière particulière. Il est également intéressant de noter que les formes de surveillance (12,2 %) et les agressions physiques (6,8 %) figurent parmi les cinq violations les plus documentées envers les personnes trans et non binaires. Ces données sont différentes de celles des femmes et des hommes cis, révélant que la violence prend des contours particuliers en fonction de la sexualité et de l’identité de genre.
Nous nous souvenons de Berta Cáceres, Margarida Alves, Marielle Franco et de tant d’autres que nous avons perdues au cours des luttes. En 2024, selon HRD Memorial, 43 meurtres de femmes dans le cadre de la défense de leurs droits ont été documentés. Le Memorial est une initiative collective mondiale de 13 organisations de défense des droits humains qui s’engagent à protéger les défenseuses des droits humains et à documenter les cas de meurtres.
Il est tout aussi important de parler des lacunes dans les données. Ni le nombre de meurtres ni le nombre des violations documentées ne sont une image exacte de la réalité. Documenter ces violences de manière cohérente est une tâche extrêmement difficile dans de nombreux contextes. De nombreuses organisations ou personnes qui pourraient piloter cet effort sont absentes de leur pays en raison des guerres ou courraient des risques excessifs en le faisant. En outre, la liberté d’expression est fortement limitée, avec la suppression d’informations, des restrictions au droit de manifester et aux actions de la société civile.
Dans le cas des femmes, la situation est encore plus critique. Il n’est pas rare que leur travail de défense des droits ne soit même pas reconnu comme travail de défenseuses, ce qui rend invisibles les risques qu’elles encourent et les violences qu’elles subissent. Par conséquent, ces violences restent dans l’ombre, sans mécanismes de protection ni de sécurité. La non-reconnaissance des femmes en tant que sujets actifs dans la lutte pour les droits est étroitement liée aux structures patriarcales qui divisent les sphères publique et privée. Dans cette division sexuelle, les femmes sont historiquement associées à la sphère privée des affections, des liens du sang, de la sensibilité, du care, de la soumission, tandis que le monde public est associé à la citoyenneté, à la liberté, aux droits, à la propriété, et donc aux hommes. La famille est considérée comme faisant partie de la sphère privée, tandis que l’État et la société civile sont considérés comme appartenant à la sphère publique. Les femmes évoluent entre la sphère publique et la sphère privée, mais leur insertion dans l’une et l’autre reste marquée par la logique de la séparation et de la hiérarchisation. Cette dynamique se reflète au sein des organisations où les femmes assument des tâches administratives, ou lorsqu’elles représentent leurs communautés à la tête de négociations dans lesquelles leurs interventions ne sont pas prises en compte.
En séparant l’espace des droits et l’espace privé et en hiérarchisant le rôle des femmes et des hommes, le patriarcat et le racisme défigurent souvent l’image des femmes en tant que sujettes de la défense des droits. Les femmes qui, en perdant un membre de leur famille, ont commencé à diriger les mouvements de recherche des disparus au Pakistan, ou les femmes autochtones du Mexique qui sont à la tête des campagnes pour la libération de leurs proches incarcérés, parcourent un long chemin pour que leur action soit reconnue au-delà de leur position d’épouse, de fille ou de mère. En franchissant les frontières entre public et privé, elles transforment leurs expériences en revendications.
La violence fait souvent réponse à l’audace des femmes qui luttent. Les attaques contre les femmes comprennent les attaques contre elles et leur famille, les campagnes de diffamation en ligne, les violences sexuelles et les menaces qui mettent en péril leur santé mentale et leur bien-être. En représailles à leur rôle de premier plan dans le mouvement de désobéissance civile qui a suivi le coup d’État au Myanmar, les femmes ont été la cible de pratiques discriminatoires, notamment d’humiliations publiques, de violences verbales et d’abus sexuels de la part de la police et des forces armées.
En plus de faire face à des risques lorsqu’elles agissent publiquement dans les luttes pour l’égalité et les droits, les femmes sont souvent des cibles instrumentalisées pour menacer leurs proches engagés dans les luttes pour les droits. Outre les risques auxquels elles s’exposent lorsqu’elles agissent publiquement dans les luttes pour l’égalité et les droits, il n’est pas rare que les femmes soient instrumentalisées pour menacer leurs proches engagés dans la lutte pour les droits. Cette dimension n’est souvent pas documentée ni même prise en compte. En 2024, dans au moins 9 cas de meurtres, des membres de la famille ont également été visés par la même attaque et, dans 36 autres cas, des membres de la famille ou des amis ont également été blessés. En 2023, 21 membres de la famille de défenseurs des droits humains ont été assassinés, dont des enfants en Afghanistan, en Colombie, au Honduras, au Soudan et aux Philippines.
- Quand les droits deviennent des crimes
Ces dernières années, nous avons assisté à une avancée alarmante de la législation qui transforme la lutte pour les droits en un acte punissable. Les lois qui devraient protéger la dignité et la liberté sont instrumentalisées pour restreindre ces droits. Ses impacts sur les groupes de défense des droits des femmes sont directs et profonds.
En mars 2023, l’Ouganda a adopté la loi anti-homosexualité, l’une des lois les plus sévères au monde contre les personnes LGBT+. Des projets similaires sont en cours dans des pays comme le Kenya et le Ghana, tandis que le Malawi, le Mali et la Tanzanie ont déjà adopté une législation criminalisant les relations homosexuelles, tout comme les militants et les organisations qui luttent pour la communauté LGBT+. En offrant un soutien juridique, psychologique ou simplement une visibilité aux personnes persécutées, ces personnes défenseuses en viennent à être considérées comme des complices et, souvent, comme des criminelles. De même, au Liban, en août 2023, des propositions législatives ont été présentées en vue de criminaliser les relations homosexuelles, aggravant ainsi le climat de répression. En novembre 2023, la Cour suprême de Russie a classé le mouvement international LGBT+ comme organisation extrémiste, interdisant ses activités et criminalisant toute forme de soutien. La décision légalise une persécution déjà systématique et insère dans la logique de la lutte contre le « terrorisme » des personnes et des groupes qui ne font que défendre le droit à l’existence et à la dignité.
Dans le contexte du génocide commis par Israël contre Gaza, le parlement israélien a récemment examiné un projet de loi, connu sous le nom de « loi CPI », qui propose de criminaliser toute forme de coopération avec la Cour pénale internationale (CPI). Le projet de loi prévoit jusqu’à cinq ans de prison pour toute personne qui partage des informations avec la CPI sans autorisation et la réclusion à perpétuité si les données sont classées confidentielles. La loi criminalise également tout langage suggérant que le gouvernement ou les autorités israéliens commettent des crimes définis par le Statut de Rome. Dans la pratique, les organisations de défense des droits humains enregistrées en Israël qui enquêtent et dénoncent les violations contre la population palestinienne sont passibles d’emprisonnement d’au moins cinq ans. Cette loi s’inscrit dans un contexte plus large d’affaiblissement de la société civile qui œuvre pour mettre fin au génocide et aux régimes d’occupation et d’apartheid. Cette proposition intervient à un moment où Israël tente de contester la compétence des tribunaux internationaux, qui ont émis des mandats d’arrêt à l’encontre de responsables israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, et qui continuent à documenter le crime de génocide contre le peuple palestinien.
Au cours des 15 dernières années, le gouvernement israélien a promu des campagnes de diffamation, des intimidations, des restrictions légales et des pressions sur les donateurs internationaux pour étouffer les entités qui dénoncent les abus et contribuent au tissu social du peuple palestinien. Par exemple, sept organisations palestiniennes ont été désignées comme terroristes en 2020, dont l’UPWC, qui fait partie de la Marche mondiale des femmes, et l’UAWC, qui fait partie de La Via Campesina. Cette mesure autocratique a été suivie d’une série d’autres attaques, y compris des arrestations et la fermeture de leurs bureaux.
Ces lois s’inscrivent dans une tendance mondiale de répression de la société civile, portée par des discours nationalistes, religieux ou sécuritaires. Sous prétexte de lutter contre le « terrorisme », de protéger la « famille » ou de préserver la « souveraineté », les États adoptent des réglementations qui restreignent les activités des organisations indépendantes et réduisent au silence les voix dissidentes. Ces concepts sont utilisés à la convenance des gouvernements, des entreprises ou des groupes fondamentalistes qui ne sont pas disposés à réguler les profits, à tolérer la dissidence, à étendre les droits des femmes, des migrants et de la communauté LGBT+, ni même à garantir le droit à l’autodétermination.
En 2023, la Commission européenne elle-même a proposé une directive sur la transparence de la représentation des intérêts au nom des pays tiers. Bien qu’elle soit présentée comme un instrument visant à prévenir l’ingérence étrangère, les organisations de la société civile préviennent que cette mesure pourrait être utilisée par les États membres de l’UE pour stigmatiser les défenseurs des droits humains, limiter l’espace civique et justifier une législation répressive dans d’autres contextes, offrant ainsi une façade juridique aux régimes autoritaires pour imiter le modèle européen sous prétexte de « transparence ».
Ces changements juridiques créent un scénario dans lequel les femmes impliquées dans la lutte pour les droits et les mouvements de solidarité sont traitées comme des menaces à l’ordre public. Leurs actions, telles que l’organisation d’une manifestation, l’offre d’un soutien juridique ou même le fait de parler publiquement des violations, peuvent être qualifiées de crimes. Il en résulte le silence des voix dissidentes, la fragmentation des mouvements et un risque personnel accru pour celles qui continuent à résister.
Stratégies à partir du féminisme
L’importance reconnue des mouvements sociaux dans la création de nouveaux cadres interprétatifs dits « cadres de l’injustice », entre en concurrence avec d’autres forces sociales pour la définition dominante de la réalité. Au sein des réseaux féministes, ces cadres s’élaborent lentement, offrant de nouvelles façons de comprendre d’anciennes réalités, telles que la violence patriarcale. Les formulations féministes d’auteurs comme Ana de Miguel soulignent que la racine de la violence à l’égard des femmes réside dans le besoin de contrôler, de s’approprier et d’exploiter le corps, la vie et la sexualité des femmes, ce qui est caractéristique du patriarcat et du capitalisme. Le patriarcat repose sur la division des femmes en deux catégories : les « saintes » et les « putes ». Dans le cadre de ce système, la violence est la punition pour celles qui ne correspondent pas au rôle de la « sainte » : la bonne mère et la bonne épouse. La violence, la menace ou la peur de la violence sont utilisées pour exclure les femmes de l’espace public et maintenir une structure injuste.
En plus de déclencher un système de violences contre les femmes à la tête des luttes pour les droits, le patriarcat érige également d’importants obstacles empêchant les femmes d’accéder aux rares options de protection leur permettant de faire face à ces risques. Nous proposons donc une question pour une réflexion future : comment nos stratégies féministes face à la violence contribuent-elles à une action collective plus sûre ?
Il y a des discussions intéressantes, comme celle apportée par Jules Falquet dans Pax neoliberalia, qui établissent des parallèles entre la torture à motivation politique et la violence domestique. La longue histoire du féminisme en matière de réflexion et de développement de stratégies pour répondre à la violence de manière plus générale continue d’être une contribution essentielle aux discussions et aux stratégies visant à protéger ceux qui défendent les droits. Les groupes de femmes sont renforcés par des réunions de dialogue, des débats, des manifestations, un travail corporel d’autodéfense, l’apprentissage et le réapprentissage de la résistance, de la construction et de la reconstruction de nos vies sans violence. Nous proposons une deuxième question pour une réflexion future : comment le féminisme participe-t-il à un réseau de care et de sécurité pour les différents mouvements et collectifs ?
Penser à la violence contre les femmes qui sont à la tête des luttes dans un contexte mondial de revers et de violence. Approfondir les stratégies féministes collectives de sécurité et de protection. Nous nous considérons comme faisant partie d’un mouvement transnational de solidarité. Cela fait partie de notre engagement collectif en faveur d’un féminisme durable.