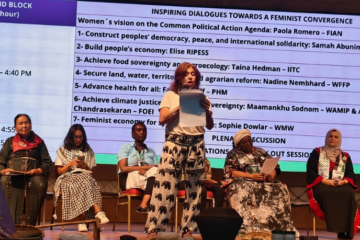Je suis originaire du Sénégal et depuis 20 ans je vis sur Turtle Island — plus précisément à Detroit, Michigan, terre ancestrale et contemporaine des Anishinaabe, également connus sous le nom de Confédération des trois feux : les peuples Ojibwe, Odawa et Potawatomi.
Détroit a d’abord été colonisée par les Français en 1701, puis reprise par les Britanniques en 1760. Son histoire a été façonnée par le colonialisme européen, y compris le déplacement des peuples autochtones et l’oppression des communautés noires. Pendant la domination française, 25 % des habitants de Detroit détenaient des personnes en esclavage. L’économie locale de l’époque reposait sur le commerce des peaux d’animaux — un système d’extraction fondé sur l’exploitation de la terre et de la vie humaine.
Pourtant, Detroit a toujours eu un esprit de résilience. C’était un arrêt important du Underground Railroad — un dernier point de passage pour ceux qui cherchaient la liberté au Canada. Aujourd’hui, si vous visitez le bord de la rivière, vous verrez une statue d’une famille noire regardant vers le nord à travers les eaux, aspirant à la liberté. Cette image capture les contradictions avec lesquelles nous vivons encore : la dissonance cognitive entre oppression et espoir.
Detroit est une ville majoritairement noire — plus de 87 % des habitants sont noirs — et pourtant elle connaît les formes les plus aiguës de colonialisme, de capitalisme et de négligence néocoloniale. Jour après jour, plus de 4 000 familles de Detroit vivent sans accès à l’eau. La ville est un désert alimentaire. De nombreux habitants vivent à plus de huit kilomètres de la source de nourriture fraîche la plus proche. Les écoles publiques de Detroit, qui accueillent plus de 50 000 élèves — dont 90 % sont noirs — manquent encore des ressources nécessaires pour assurer une éducation de qualité. Ces conditions ne sont pas accidentelles. Elles sont l’héritage du racisme structurel et de la négligence économique.
En tant qu’immigrante africaine, je vis le colonialisme et le néo-colonialisme tous les jours. Nous sommes constamment tenues de prouver notre valeur, nos connaissances, nos références. Notre formation est remise en question. Notre leadership est contesté. Le résultat est que beaucoup d’entre nous se surchargent — poussées à être deux fois plus bonnes juste pour être considérées comme des égales. Ce fardeau psychologique se manifeste souvent par le syndrome de l’imposteur, un poids silencieux porté par d’innombrables professionnels noirs à qui on dit qu’ils doivent en faire plus, parler mieux et aller plus loin pour compter.
Nous voyons cette violence déborder dans les rues — en particulier sous la forme d’une police excessive et d’une criminalisation. Le meurtre de George Floyd n’était pas une anomalie. C’était le symptôme d’un système qui veille et persécute les corps noirs. Bien qu’ils ne représentent que 14 % de la population américaine, les Noirs représentent plus de 25 % de la population carcérale. Que l’on soit afro-américain ou immigrant africain, ces systèmes nous affectent également. En fait, les statistiques montrent que les immigrants noirs représentent 5 % de la population sans papiers, mais entre 20 et 26 % des personnes incarcérées, détenues et expulsées.
Le colonialisme ne s’arrête pas aux frontières nationales — il opère à l’échelle mondiale. Au Sénégal, où je suis née, nous avons eu de multiples administrations depuis l’indépendance, mais nous avons encore du mal à définir notre démocratie selon nos propres termes. Nous devons revenir à nos pratiques autochtones, à la sagesse ancestrale, et rejeter les modèles extractifs du capitalisme qui continuent de nous appauvrir.
L’Afrique n’est pas pauvre. Elle était appauvrie — par cupidité. Le continent est riche en ressources, c’est exactement pourquoi il a été ciblé par des puissances mondiales exploiteuses. Tant que l’Occident continuera d’exploiter, de polluer et d’extraire sous couvert de développement, les communautés africaines continueront de lutter pour subvenir à leurs besoins. Et tant que cette exploitation se poursuivra, les gens continueront de migrer —traversant les frontières ou les mers, non par désir, mais par survie.
Il est important d’être clair : si les pays pouvaient conserver leurs ressources, ils conserveraient leurs populations.
Prenez la République démocratique du Congo. Ce pays a fait face à des décennies de conflits, non pas à cause de divisions internes, mais parce qu’il repose sur certains des gisements minéraux les plus riches de la planète — des ressources dont dépendent les industries mondiales. L’instabilité du Congo est fabriquée pour le profit.
Nous avons besoin de nouveaux modèles de gouvernance ancrés dans nos propres traditions. La démocratie ne peut pas seulement signifier des élections ou des institutions occidentales. Cela devrait signifier une prise de décision collective fondée sur la justice, la sollicitude et l’autodétermination. Le monde est à un point de rupture et notre survie dépend de la réinvention du pouvoir — pas seulement de la réforme des systèmes, mais de leur transformation.
Nous devons rêver au-delà des structures qui nous ont fait défaut. Nous devons construire des relations, de la solidarité et de la souveraineté qui traversent les frontières. Et surtout, nous devons retourner sur notre terre — pas seulement physiquement, mais spirituellement, politiquement et écologiquement.
L’avenir est entre nos mains, mais seulement si nous le revendiquons.
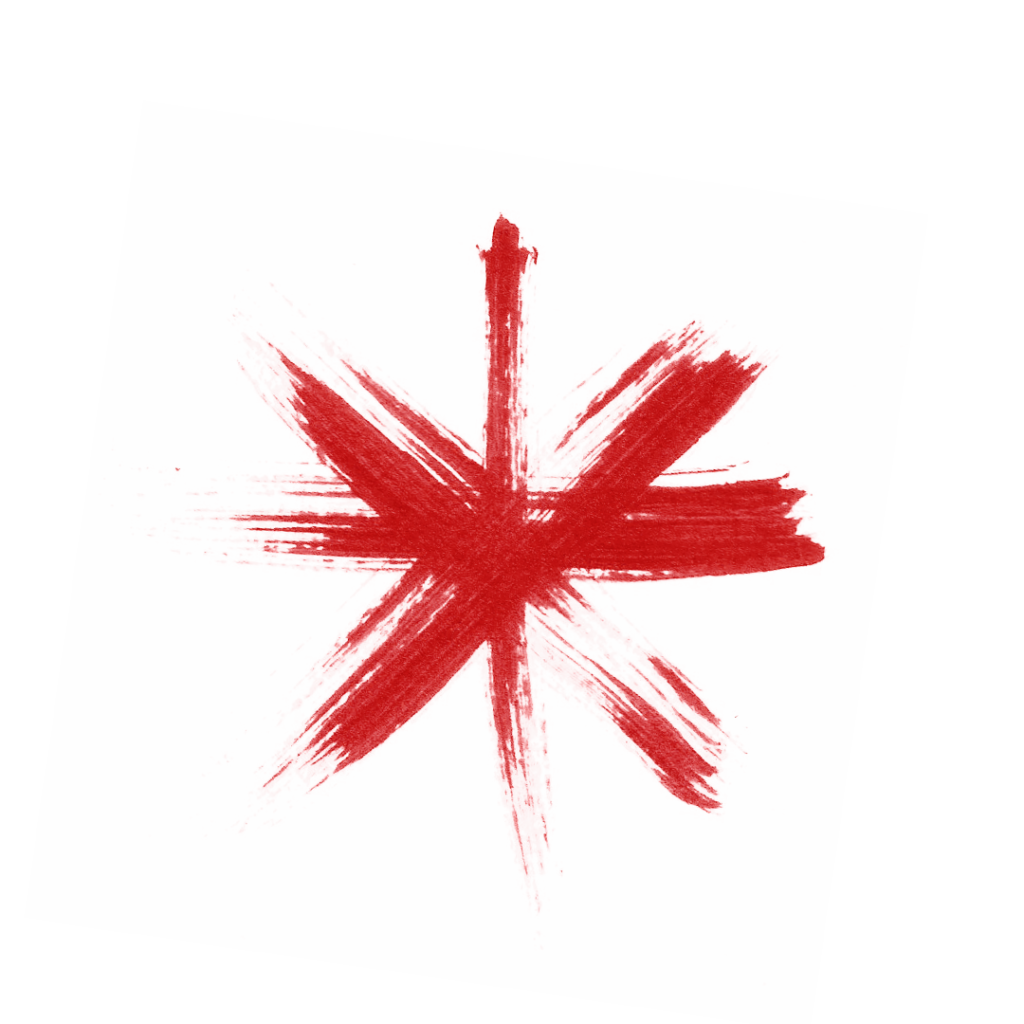
Docteure Seydi Sarr est membre du Bureau africain pour les immigrants et les affaires sociales (African Bureau for Immigrants and Social Affairs — ABISA), une organisation qui défend les droits des immigrants aux États-Unis. Cet article est une édition de son discours lors du webinaire « Les impacts du colonialisme sur l’Afrique et les communautés afro-descendantes », organisé par l’École Internationale d’organisation féministe (IFOS), le 4 mars 2025.