Connaître des expériences de reconstruction féministe et populaire dans différents territoires nous permet d’élaborer des points de départ et des moyens collectifs de réorganiser la vie face aux événements météorologiques extrêmes. Pour la Marche Mondiale des Femmes, les événements météorologiques extrêmes ne sont pas déconnectés des causes du changement climatique. Ils font partie du modèle actuel de reproduction, de production et de consommation dans le système multiple des oppressions et approfondissent le conflit entre le capital et la vie. À partir de l’organisation collective des femmes, nous avons mis en place des pratiques et des initiatives qui mettent la solidarité au centre pour assurer la pérennité de la vie dans des conditions défavorables. Dans le webinaire « Expériences de reconstruction féministe après des catastrophes environnementales », nous avons partagé des expériences de reconstruction au Brésil, en Haïti, à Cuba et en Turquie. Dans tous ces territoires, nous combinons les pratiques de reconstruction et de solidarité féministe avec un agenda politique qui confronte la dynamique de l’expansion du capital. Ce webinaire, qui s’est tenu le 29 septembre, a été organisé par Capire en partenariat avec les organisations brésiliennes qui composent la Marche Mondiale des Femmes, SOF Sempreviva Organização Feminista et CF8 Centro Feminista 8 de Março.
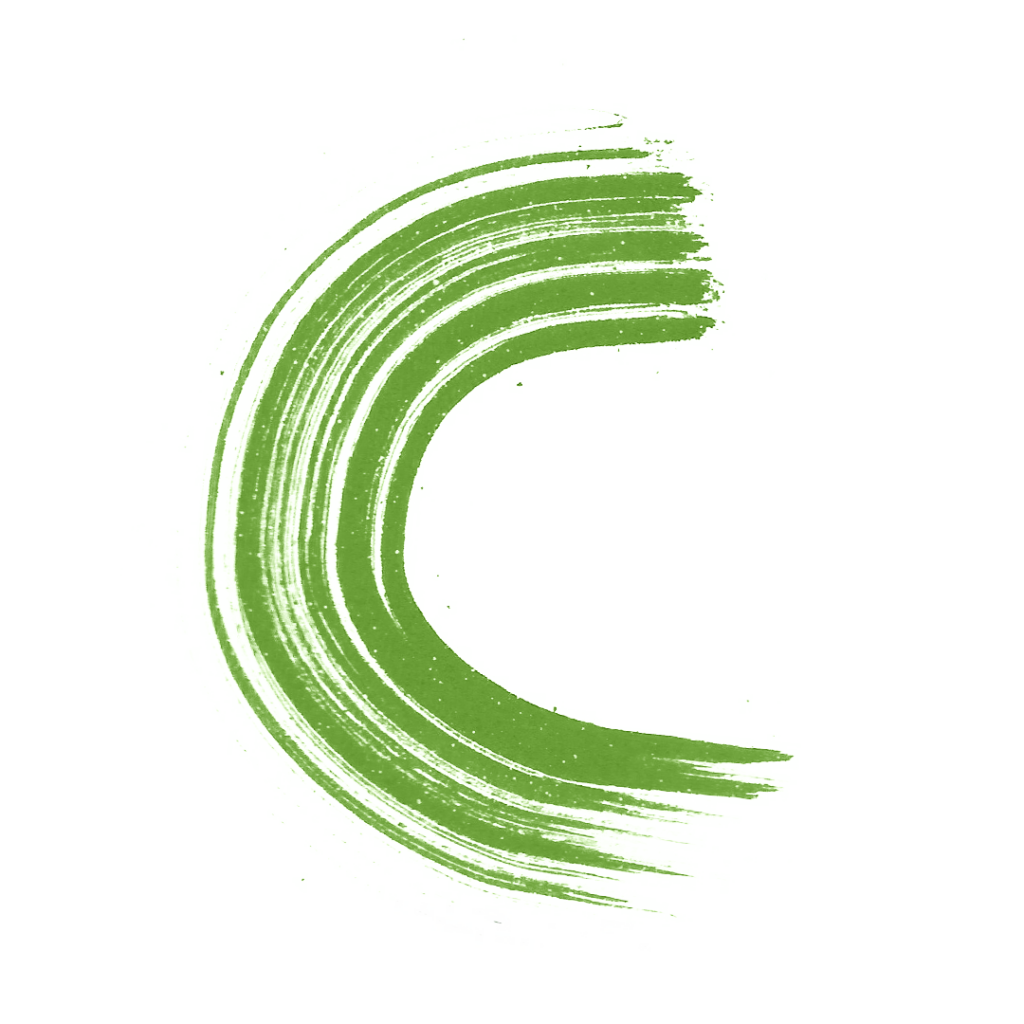
Je suis membre de la Solidarité Fromaïcienne (SOFA) qui va avoir en février 2026 ses 40 ans de travail d’existence en Haïti. C’est la SOFA qui coordonne la Marche mondiale des femmes en Haïti. C’est un plaisir pour l’ASOFA de partager ses expériences avec vous, les expériences des femmes.
Si on prend le cas d’Haïti, on peut dire que le pays vit depuis toujours sous la menace des catastrophes naturelles, que ce soit des séismes, des huracans ou des tempêtes. Et ça rythme non seulement l’histoire, mais ça influence aussi la vie sociale, culturelle et politique du pays. Si on fait une petite historique des catastrophes naturelles en Haïti, on peut remonter depuis 1960 pour arriver à 2021-2022.
Et on a été frappés par divers huracans, dont les tempêtes de Flora en 1970 et en 1914. Et on a été aussi frappés par l’Huracan Georges. Ce sont des huracans en vie humaine et beaucoup de pertes en infrastructures au niveau du pays.
Ce sont aussi des catastrophes qui, de la mémoire collective et répétée, ont profondément marqué non seulement la mémoire des communautés, mais ça donne aussi naissance à des récits de survie. Il y a nos grands-parents qui nous expliquent comment ces catastrophes ont été passées, comment des personnes ont arrivé à survivre de ces catastrophes et après comment elles se sont organisées autour des pratiques de solidarité et de résilience. Mais on peut voir qu’après 1990 pour arriver vers les années 2000, qu’il y a eu une fréquence accrue des catastrophes naturelles en Haïti qui se sont intensifiées et rapprochées dans le temps.
On a fait face aux pluies torrentielles et inondations en 2004, à l’Huracan Jeanne en 2004 aussi, à Tempête Faille, à l’Huracan Gustave en 2008 et on a frappé par le grand tremblement de terre de 2010 qui a occasionné près de 300 000 morts selon les données qui ont été présentées. Ce qu’on a pu comprendre, c’est que la dégradation de l’environnement, notamment la déforestation massive liée aux conditions de précarité, à la situation de précarité, aux vulnérabilités du pays, ont fait qu’à partir de 2000, les catastrophes naturelles se sont intensifiées. Le séisme du 2 janvier a été vraiment frappé par ce séisme dévastateur qui a emporté la vie de trois figures emblématiques du mouvement féministe haïtien.
On a perdu Margalie Massenet, qui était la fondatrice de l’organisation Timeform et qui est une autre organisation dédiée à la défense des droits des femmes. On a perdu Anne-Marie Coriolan, qui était une militante très engagée dans la lutte pour les droits des femmes, qui a disparu lors du séisme. Et l’une a aussi perdu Myriam Merlet, qui a joué un rôle clé dans la reconnaissance du viol comme crime en Haïti.
Ce sont trois figures emblématiques. Non seulement le tremblement de terre a emporté beaucoup de nos frères et soeurs, mais il a affecté le mouvement féministe par la perte de ces trois femmes. Et ce qui a été pour la SOFA très important au lendemain du tremblement de terre et sur toutes les organisations féministes, c’était d’organiser une cérémonie symbolique en hommage à ces trois femmes.
Leurs corps n’ont jamais été retrouvés. On a pu organiser une cérémonie symbolique, comme je disais tantôt, pour rendre hommage à leur mémoire et surtout marquer la continuité de leur combat pour les droits des femmes, malgré la tragédie. Ça, c’était au lendemain du tremblement de terre.
Mais après, le 8 mars 2011, et le 8 mars de la même année, les organisations féministes dans la SOFA marchaient en mémoire des femmes qui sont tombées à cause du tremblement de terre, mais particulièrement en mémoire de ces trois femmes. Il y avait des milliers de personnes à participer et à investir leurs roues de parcours en mémoire des victimes du tremblement de terre, en particulier les femmes. Quand la catastrophe naturelle frappe le pays, les organisations, je peux dire que ce sont les Haïtiens eux-mêmes, Haïtiens et Haïtiennes, qui se sont organisés pour porter ce coup aux survivantes.
Ils développent un élan de solidarité pour venir en aide aux survivantes. Par exemple, ce sont eux qui mettent en place des brigades de soutien, des brigades de protection. Mais on peut noter un élan de solidarité vraiment manifeste du côté des femmes, qui non seulement participent à aider leurs confrères et consoeurs, mais aussi à assurer la continuité des soins, à assurer la distribution des médicaments auprès des blessés et accompagner surtout les survivants de ces phénomènes.
Par exemple, depuis le passage du cyclone Bordone des années 90 jusqu’aux catastrophes récentes, la solidarité fromaïcienne, la SOFA, a développé une approche, disons, qui a plusieurs échelons et qui prend en compte vraiment les trois moments clés quand on est en face des catastrophes naturelles. Cette approche prend en compte la gestion de l’urgence. Par exemple, en 2010 et en 2016 avec le cyclone Mathieu, la SOFA a répondu vraiment et de manière spontanée et rapidement aux besoins vitaux des populations affectées.
On a monté tout un réseau avec d’autres organisations de femmes, avec d’autres femmes pour distribuer de la nourriture, collecter des vêtements et les distribuer, vraiment faire des kits d’hygiène spécifiquement pour les femmes. Et on a aussi partagé notre savoir-faire avec les femmes pour les aider à passer le camp. L’importance pour nous, c’est une phase vraiment importante parce que ça réside dans la sauvegarde immédiate de vie et le soutien aux personnes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants qui sont souvent les plus touchés.
C’est la première phase de notre intervention quotidienne des catastrophes naturelles, mais aussi on agit au niveau du relèvement parce qu’après l’urgence, la phase de relèvement, nous nous concentrons vraiment sur le soutien psychosocial, sur la lutte contre la violence et sur le renforcement des capacités locales, en particulier des femmes. La SOFA a mis en place diverses cellules de soutien psychosocial dans le Sud, dans la Grande-Anse et dans les régions les plus réculées où il y a vraiment une absence flagrante de l’État. On a animé des groupes de soutien pour aider vraiment les survivants, surtout les femmes, à faire face aux traumatismes, aux séquelles des catastrophes naturelles.
Ça a permis vraiment de restaurer la cohésion sociale, la preuve qu’on a pu voir comment l’accompagnement de ces personnes dans leurs traumatismes a permis que les communautés soient plus prêtes à affronter et à gérer les traumas résultant de ces catastrophes naturelles. Ça aussi a permis à la SOFA de transformer les rapports de pouvoir au niveau des communautés. C’est une phase vraiment qui a souligné, qui a montré comment l’intervention sociale ne se limite pas à l’aide matérielle, mais inclut aussi la reconstruction du tissu social et émotionnel.
On a aussi agi au niveau de la reconstruction en accompagnant les communautés via des accompagnements sociaux et économiques après les catastrophes. Et on a compris que la relance des communautés peut passer à travers des projets économiques, à travers la consolidation de la résilience communautaire. La SOFA a mis en place des actions génératrices de revenus et a développé, a appuyé les femmes dans leurs initiatives, dans leurs activités agricoles et artisanales.
On a aussi appuyé certaines femmes à la reconstruction de leurs habitations qui étaient détruites. Ça a permis de renforcer l’autonomie de ces femmes et de ces communautés en valorisant le rôle des femmes dans le leadership local et en transformant les dynamiques de pouvoir. On a aussi joué le rôle de vigie parce que non seulement il y avait des femmes qui s’impliquaient activement à participer, à faire de la solidarité à la population haïtienne, mais il y avait aussi l’aide internationale dont nous ne pouvons pas nous empasser.
Et cette aide humanitaire a laissé aussi important, je peux dire, qu’ils étaient et aussi important que l’aide humanitaire était, elle a aussi laissé des conséquences néfastes pour le pays parce qu’à chaque fois qu’il y a des catastrophes naturelles. On a pu jouer un rôle de vigie après les catastrophes naturelles pour vraiment avoir une vue ou bien une surveillance sur la distribution de l’aide. Parce qu’après, au Konaï par exemple, des membres de la SOFA nous rapportaient qu’après les catastrophes naturelles, elles étaient exclues des aides humanitaires parce qu’elles étaient membres de l’ASOFA et comme membres de la SOFA, les personnes qui distribuent les aides humanitaires se disent « bon, vous êtes membre d’une grande organisation donc vous n’avez pas besoin de cette aide ». Et des fois, ils utilisent l’aide comme étant un outil pour renforcer leur influence politique, etc.
Ce qui fait que la SOFA ou bien les femmes ont joué un rôle de surveillance et d’observation afin de s’assurer non seulement que les principes humanitaires soient respectés mais aussi de plaider en faveur de la partialité et de la neutralité et aussi de s’opposer à la localisation excessive de l’aide qui pourrait favoriser certaines populations au détriment d’autres. Ce qu’on peut voir, c’est que ces événements ont fait que l’aide internationale soit affluée en Haïti avec toutes leurs conséquences. Par exemple, si on prend le scandale d’Oxfam, le scandale de Clinton après le séisme du 12 janvier, on voit que ces scandales ont servi de point de départ pour formaliser et vraiment renforcer l’aide humanitaire dans le pays.
L’exemple haïtien a inspiré l’adoption de politiques strictes telles que la politique zéro tolérance et la politique de lutte contre la fraude et la corruption. Et ces réformes visent vraiment à assurer la transparence, la responsabilité et la protection effective des populations. Les catastrophes naturelles en Haïti ont révélé à la fois la fragilité des institutions et la force des communautés, en particulier la force des femmes.
Et la SOFA montre à chaque fois comment l’action locale qui combine secours immédiats, soutien psychosocial et reconstruction économique peut transformer les rapports de pouvoir et renforcer les capacités des communautés. Comme je l’ai dit au commencement, j’étais très contente de partager l’expérience haïtienne avec vous. Et c’est là que je mets un terme à ma présentation.




