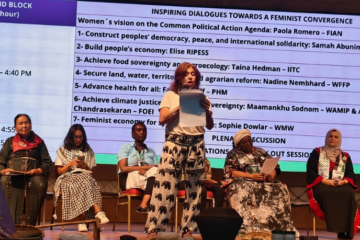Le 24 avril est une date de lutte pour le mouvement féministe mondial. Il s’agit de la Journée de solidarité internationale contre le pouvoir des sociétés transnationales, une journée d’action à l’appel de la Marche Mondiale des Femmes. La journée remémore les plus d’un millier de personnes travailleuses, principalement des femmes, décédés le 24 avril 2013 en raison de l’effondrement du complexe industriel du Rana Plaza au Bangladesh. Les longues et intenses heures de travail sans droits et le mauvais état de la structure du bâtiment annonçaient déjà la tragédie criminelle dans ces ateliers qui fournissaient des vêtements à des entreprises textiles transnationales telles que Walmart et Benetton.
Pour contribuer aux débats sur le pouvoir des sociétés transnationales et leurs impacts politiques dans les pays du Sud, nous partageons quelques extraits du rapport Les sociétés transnationales et l’extrême droite en Amérique latine, produit par l’Observatoire du travail des Amériques, lié à la Confédération syndicale des Amériques (CSA). L’article examine les relations entre le pouvoir des entreprises, l’exploitation du travail et de la nature, et l’approfondissement du néolibéralisme et des programmes d’extrême droite, qui sont antiféministes et menacent les démocraties.
Le document réfléchit aux nouvelles « modalités » de coup d’État mises en pratique dans des pays comme le Honduras en 2009, le Paraguay en 2012, le Brésil en 2016 et la Bolivie en 2019. Ces coups d’État faisaient partie des stratégies de réorganisation du capitalisme dans la région, dans une alliance entre les élites politiques et les puissances économiques nationales et internationales. À bien des égards, les sociétés transnationales sont des menaces pour la souveraineté des peuples.
Le rapport de la CSA décrit les principales activités des sociétés transnationales en Amérique latine et leurs relations avec la situation politique de chaque pays. En exploitant les ressources naturelles, elles sont responsables de la déforestation, de la contamination, de la violence et des conflits avec les communautés locales et traditionnelles. Elles sont également le fer de lance de grands projets d’infrastructure et d’énergie, poussant à la privatisation, à la réduction de la réglementation et de l’intervention de l’État et à la précarité des emplois. De plus, le travail intensif des entreprises de télécommunications et de technologie est basé sur l’exploitation du travail à travers des plateformes numériques, avec un discours de flexibilité qui masque le déni des droits.
Dans l’industrie textile, les transnationales exploitent une main-d’œuvre bon marché et précaire et profitent des politiques d’incitation fiscale. Un exemple est celui du Honduras, où « l’industrie textile a prospéré sous un modèle de zone de libre-échange qui profite aux transnationales américaines et asiatiques. Les maquilas dans des villes comme San Pedro Sula produisent des vêtements pour des marques internationales, grâce à des incitations fiscales et à des réglementations du travail flexibles. » Cette stratégie s’est intensifiée après le coup d’État et pendant les gouvernements de droite qui ont suivi, perpétuant « les inégalités et la dépendance économique du pays ».
*
Les chaînes de production mondiales dans le renouveau du néolibéralisme en Amérique latine
Les chaînes de production mondiales (CPM) sont une composante essentielle du néolibéralisme, et l’Amérique latine a été un territoire de très grande importance dans son processus de division internationale de la production. (…) Les CPM sont composées de sociétés transnationales dirigées par une société mère située dans un pays du Nord global. Cette matrice non seulement contrôle et gère une chaîne de production mondiale, mais supervise également la production, détermine la valeur du produit et prend des décisions concernant sa commercialisation et sa distribution, favorisant la sous-traitance des différentes étapes de ces processus à d’autres entreprises.
Les CPM favorisent la différenciation entre les pays, car ils sont insérés différemment dans les économies mondiales. Dans le contexte latino-américain, les sociétés transnationales transfèrent les charges sociales, environnementales et du travail, ainsi que les menaces pesant sur les organisations et les institutions des démocraties, vers les pays du Sud global.
En Amérique latine, un exemple emblématique est la United Fruit Company, rebaptisée Chiquitas Brand International, une société transnationale états-unienne qui s’est implantée en Amérique centrale et contrôlait la production et la commercialisation de fruits tropicaux. Cette entreprise était une force politique et économique et a même stimulé plusieurs coups d’État dans la région.
Dans le monde du travail, les sociétés transnationales favorisent le travail informel, temporaire et précaire dans nos pays. Ainsi, elles adoptent des formes d’intensification du travail, avec un fort contrôle de l’activité, l’imposition d’objectifs, de longues heures de travail, une faible protection de la santé, une faible sécurité au travail, de bas salaires et une limitation de la négociation collective et de l’organisation syndicale.
Les CPM peuvent être considérées comme une réaction des sociétés transnationales aux obstacles imposés à l’économie de marché libre par le néolibéralisme. En ce sens, elles ont été fondamentales dans une série de mesures visant à réduire la capacité de production et de surveillance de l’État. Lorsque ce ne sont pas leurs alliés qui remportent les élections, les sociétés transnationales favorisent la détérioration ou l’effondrement des démocraties. Ce modèle a redéfini le profil des travailleurs et limité la capacité des syndicats et des institutions étatiques à réglementer le travail pour agir.
Au cours de la période récente, les sociétés transnationales ont joué un rôle crucial dans la perturbation des chaînes de production nationales et régionales, comme dans le cas de la chaîne de production de pétrole en Amérique latine. Ses principaux domaines d’activité dans la région comprennent des secteurs clés tels que les métaux, l’énergie, les produits carnés et les produits agricoles.
Dernières considérations
(…) Premièrement, la version renouvelée mais encore plus radicale du néolibéralisme promue par l’extrême droite renforce et approfondit les idées, les discours et les politiques anti-Étatiques, consolidant la primauté du marché sur l’État. Cette approche non seulement affaiblit la capacité des institutions publiques à réguler et redistribuer, mais légitime également les inégalités structurelles en hiérarchisant les intérêts économiques au détriment du bien-être social.
Deuxièmement, il est essentiel de rouvrir le débat sur la relation entre l’argent et la politique, un lien évident dans des cas tels que la relation entre Trump et Musk, qui symbolise comment le néolibéralisme agit comme un pont entre l’extrême droite et les sociétés transnationales. Ce document abordait l’émergence et la consolidation de l’extrême droite en Amérique latine, explorant les nouveaux schémas et interactions qu’elle établit avec les entreprises mondiales, marqués par des intérêts partagés qui favorisent la déréglementation et la concentration du pouvoir économique.
L’agenda des sociétés transnationales converge avec celui de l’extrême droite, car les deux privilégient les avantages du capitalisme, même au prix de l’érosion des démocraties. L’un des impacts les plus significatifs de cette alliance se manifeste dans le monde du travail, où la déréglementation financière affaiblit les systèmes de sécurité sociale, tandis que la déréglementation du travail nuit directement aux droits collectifs des travailleurs, rendant leurs conditions de vie et de travail plus précaires.
Cette approche non seulement approfondit les inégalités sociales, mais limite également les possibilités d’organisation syndicale et de négociation collective, essentielles pour équilibrer les relations de pouvoir entre employeurs et employés. Dans ce contexte, il est essentiel de repenser les modèles réglementaires qui privilégient le bien-être social aux intérêts d’une économie trop concentrée.
(…) Le triomphe de Trump a marqué le début d’une nouvelle étape pour l’extrême droite dans la sphère transnationale, caractérisée par une plus grande audace et une absence de dissimulation : le capital transnational agit ouvertement en faveur de son agenda, promouvant des politiques qui renforcent son pouvoir économique et politique. Dans ce contexte, le syndicalisme sociopolitique est confronté au défi de comprendre en profondeur la nature et les stratégies de cet acteur mondial. Un diagnostic précis est non seulement nécessaire, mais urgent afin de développer des réponses efficaces qui défendent les droits du travail, la justice sociale et les valeurs démocratiques face à une offensive de plus en plus organisée et mondialisée.