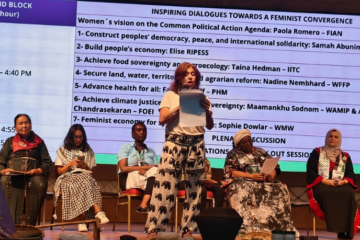Au cours de ce siècle, l’Amérique latine est passée de la construction de processus de transformations sans précédent à des moments très difficiles de régression et de destruction. L’économie féministe dans notre région s’est développée et a consolidé une vision systémique qui affronte cette réalité, faisant partie de la génération de pensée et de mouvement, de multiples initiatives de résistance et d’alternatives. Ainsi, lorsque nous parlons de femmes et d’économie féministe, nous ne parlons pas d’un secteur, d’une partie d’un tout, mais du système dans son ensemble.
Dans cette vision systémique que nous encourageons, il apparaît clairement que la notion élargie de vie est centrale. Nous comprenons la vie comme un système intégral et comme une catégorie analytique qui renvoie aux dimensions matérielles et relationnelles, qui constituent à leur tour l’axe de l’économie. Il s’agit d’un système intégral dont nous faisons partie, où nous sommes interdépendant·es et où les flux de care sont essentiels, tout comme les principes de diversité, de collaboration et de complémentarité. La vie implique une coévolution, une dynamique complexe de conditions qui ont été créées et recréées tout au long de l’histoire.
Dans cette trajectoire, les femmes ont joué des rôles fondamentaux qui sont aujourd’hui reconnus et émergents, mais qui ont longtemps été dévalorisés ou ignorés. Le travail de reproduction et de care, l’agriculture et les rituels, par exemple, expriment cette relation entre la nature et les connaissances des femmes sur les processus de la vie. En mettant l’accent sur cette perspective, il devient nécessaire de repenser la relation entre culture et nature, qui est l’une des dimensions clés de l’interprétation des systèmes sexe-genre.
Selon une perspective féministe plus occidentale, l’un des principes serait de dissocier les femmes de la nature pour montrer que le sexe et le genre sont des constructions culturelles. D’un point de vue politique et analytique, c’est important et cela reste un outil fondamental. En même temps, ces dernières années, nous avons réinterprété le sens de l’idée selon laquelle la nature n’est pas une réalité extérieure, séparée de nous ; elle n’est pas quelque chose qui existerait « là-bas », pendant que les êtres humains seraient « ici ». En tant que partie intégrante de la nature, nous comprenons qu’elle est une co-construction de la vie. En elle, les femmes sont la nature. Nous devons le révéler, non pas dans un sens fondamentaliste qui consisterait à nous attribuer des rôles, mais dans le sens de cette richesse de travail, de rituel, de poésie, de tout ce qui, historiquement, a été impliqué dans la cocréation et le soutien de la nature, et maintenant dans le défi de la recouvrer et de la restaurer.
La richesse des expériences et des réflexions collectives permettent de repenser, rediscuter et nourrir d’autres questions. L’une des questions fondamentales dans le développement de l’économie féministe ces dernières années a été l’identification du phénomène de la marchandisation de la vie. Je veux ici rappeler le souvenir toujours vivant de Nalu Faria, avec qui nous avons abordé cette question au début du siècle. Pour parler de démercantilisation, nous devons comprendre comment la marchandisation est apparue, jusqu’où elle est allée et quelle menace elle représente.
Quels processus ont conduit à la marchandisation ? Et comment allons-nous la désactiver ?
La mise en œuvre d’un marché total en Amérique latine s’est faite par le biais d’ajustements néolibéraux, dans lesquels les processus de production de biens et de services et les conditions de vie ont été cooptés et absorbés par le marché. L’économie n’est pas seulement ce qui est monétisé ou marchandisé. L’économie est l’ensemble des activités de production, de reproduction, de services et de relations, avec ou sans monnaie. C’est la création non seulement de marchandises, mais aussi de biens et de relations, de conditions de vie.
L’un des piliers de l’économie féministe est de comprendre la totalité et les interrelations qui se produisent entre cette économie de marché (ou économie marchandisée) et cette autre économie qui prend différentes formes dans nos pays. En Amérique latine et en Afrique, le système capitaliste cherche à hégémoniser et à dominer d’autres formes de production, d’autres formes de propriété et de relations communautaires et de voisinage. À partir de ces formes et de ces pratiques, dans lesquelles les femmes sont majoritaires, nous pouvons réfléchir à la possibilité de transformer le système.
Nous pensons que l’une des clés de la démercantilisation réside précisément dans ce qui existe déjà : des pratiques du capitalisme différentes et des relations différentes avec lui. Même si ces pratiques et relations sont dominées et soumises, elles résistent. Préserver cela est non seulement fondamental dans l’immédiat pour générer un care de grande envergure, mais c’est aussi la clé de la transition. Nous ne pourrons évoluer vers quelque chose de différent que si nous parvenons à maintenir, à contrôler et à élargir les possibilités de production et de reproduction actuelles. Si nous perdons cela, comment ferons-nous la transition ? Comment affronter les pouvoirs oligarchiques universels qui nous dominent aujourd’hui ?
L’ampleur du pouvoir qui se déploie actuellement est immense et nous laisse presque désorientées. Mais où pouvons-nous commencer à transformer, si ce n’est à partir de ce que nous pouvons contrôler en termes de création de conditions de vie ?
La marchandisation que nous avons connue au cours des dernières décennies a cherché à éliminer diverses formes de travail et à intérioriser des visions, par exemple, de ce que l’on appelle l’autonomisation des femmes. Aujourd’hui, on se rend compte que même les points de vue féministes néolibéraux ont été intégrés, ce qui semblait impossible au début du siècle. Le système nous vend l’idée que, pour échapper à la domination, nous devons nous tourner vers le marché capitaliste, avoir un emploi et un revenu dans le cadre d’un régime de dépendance salariale, comme clé de notre émancipation. Souvent, cela ne signifie pas passer de « l’inactivité » économique à « l’activité » économique, mais plutôt remplacer des formes de travail et de production. Par exemple, lorsqu’une femme quitte une économie familiale et paysanne pour travailler comme vendeuse dans un supermarché, ses formes antérieures de production, de connaissance et d’expertise sont annulées.
L’attaque contre la diversité économique et l’imposition d’aspirations à un modèle économique capitaliste unique sont d’autres défis. Comment penser un travail digne et porteur de droits dans un contexte de modèles économiques diversifiés ? Comment créer d’autres conditions dans des endroits où il n’y a ni emploi ni protection sociale formelle ? C’est un défi pour nous et pour les politiques publiques de générer des approches alternatives qui élargissent les définitions des droits pour couvrir différentes conditions de réalité sociale et économique.
La marchandisation de la vie a conduit à la transformation des besoins en marchandises. Comment puis-je satisfaire mon besoin ? J’ai de l’argent pour acheter une marchandise. C’est cette vision qui est promue, et les besoins en tant que droits sont déformés. Il y a plus de 70 ans, Eva Perón formulait la prémisse « Là où il y a un besoin, il y a un droit ». Cette prémisse intéressante, qui anticipait le discours des Nations Unies, n’est pas aujourd’hui attaquée sans intérêts par Milei. En résumé, un ensemble de mécanismes de pouvoir corporatif s’est développé, intégrant une vision, des valeurs et des pratiques propres au processus de marchandisation.
La concentration du capital et de la richesse à des niveaux sans précédent exprime l’ampleur du néolibéralisme dans nos pays d’Amérique latine. Ceci est directement lié à l’expansion de la logique d’entreprise en tant qu’idéal pour l’économie et la société, un phénomène encouragé à l’échelle mondiale par divers moyens. Il existe des analyses rétrospectives et historiques qui montrent comment les États-Unis ont construit l’idée des affaires comme clé, cellule idéale de la société. Sa contrepartie était la destruction de diverses formes de propriété, de production et de travail, projetant que ce qui est bon est ce qui est disponible sur le marché. L’expansion du marché vers la reproduction de la vie est une instrumentalisation de la question de savoir comment satisfaire les besoins.
Il y a de nombreuses années, lors des débats autour des unités domestiques, du travail domestique et de l’alimentation, on évoquait le rêve d’une maison sans cuisine, perçue comme le bastion de l’oppression des femmes condamnées à cuisiner. Avoir une maison sans cuisine était libérateur. Aujourd’hui, ce rêve peut devenir réalité, mais en termes de conquête du marché, par le biais d’une marchandisation extrême. Tout est objet de luttes. Il est impressionnant de voir comment le marché a réussi à s’emparer de certaines formulations issues d’une vision antisystémique, à les reformuler et à nous donner une nouvelle perspective terrifiante.
Un autre élément pertinent est le pillage des ressources et le boycott des droits et des conditions de vie des populations appauvries. Le processus que nous avons connu au cours des dernières décennies donne lieu à des exodes massifs, à des phénomènes migratoires critiques et à l’essor d’économies mafieuses. Tout cela suit une logique commerciale, une détérioration des notions de vie et de société et tend vers un déplacement et une restructuration de la subjectivité.
En même temps, et face à ces tendances dominantes, les expériences progressistes que nous avons vécues au cours des dernières décennies nous ont laissé une accumulation d’expériences. En partant de l’économie féministe, nous avons dû relever le défi d’élargir nos analyses et nos propositions pour faire de la vie la pierre angulaire de toutes les politiques macroéconomiques, sectorielles et locales.
Au cours de ce que l’on pourrait appeler les « décennies progressistes », nous avons proposé un autre système, nous avons envisagé le « bien vivre » comme système alternatif. En termes économiques, il s’est exprimé dans le cas équatorien comme un système économique social et solidaire. Ces étapes ont été extrêmement importantes pour les expériences qui s’articulaient alors dans les réseaux d’économie sociale et solidaire, les coopératives et la souveraineté alimentaire. Tout cela a convergé dans les politiques publiques, dans les propositions, dans les constitutions, et c’est un héritage que nous ne pouvons pas abandonner, un héritage que nous devons conserver comme bouclier contre l’attaque que nous subissons actuellement, en le positionnant comme une possibilité pour l’avenir.
Quel agenda nous aidera à naviguer dans ces eaux troubles ?
Un premier élément concerne la conception d’une économie pour la reproduction élargie de la vie par opposition à la reproduction élargie du capital. Cela signifie qu’il faut redéfinir la matrice de production et d’énergie et éliminer l’extractivisme, l’exploitation, l’inégalité et la destruction. Ce sont des questions d’échelle. Les économies alternatives restent parfois trop figées en termes micro (communautaires, locaux) mais nous devons voir les choses aux niveaux mondial, régional et national. De petites solutions, si elles sont conçues comme complémentaires, peuvent entraîner de grands changements.
Nous devons, bien sûr, défendre l’économie du care, mais pas de manière marchandisée. L’économie du care a déjà franchi un seuil de reconnaissance : dans une large mesure, la visibilité a déjà été largement atteinte. La question est de savoir comment s’assurer qu’elle est conçue et consolidée en termes non marchands. La défense de l’État et de la sphère publique, qui est une condition de la reconnaissance, de la redistribution et de l’exercice des droits, est une question très importante. Si la sphère publique venait à disparaître, notre capacité à revendiquer et à garantir les droits perdrait tout fondement. Nous ne pouvons pas nous en tenir uniquement à des notions de communauté qui, comme les autres, sont elles aussi en train d’être récupérées. De quelle communauté parlons-nous ? Quelle est sa portée ? Comment nous différencier des communautés instrumentalisées ?
Nous avons besoin d’une vision différente de l’autonomisation économique qui ne soit pas ancrée dans des solutions de marché. Pour y parvenir, il est important que la contribution historique des femmes, notre action et son potentiel de transformation soient visibles et reconnus.
L’économie féministe s’est développée et a le potentiel de converger vers la construction d’autres systèmes. C’est une capacité qui vient de l’expérience. Nous, les femmes, nous faisons l’économie différemment, avec d’autres bagages, avec d’autres connaissances. Nous avons devant nous un énorme programme de relecture, de réinterprétation, de réflexion commune sur des sujets clés afin de faire avancer un peu plus notre programme. Sinon, on a parfois l’impression d’en être encore au même point. Et c’est le moment d’opérer un véritable saut qualitatif pour aller encore plus loin.
Magdalena León est une économiste féministe et membre du Réseau lationoaméricain des femmes pour la transformation de l’économie (Remte) en Équateur. Cet article est une transcription éditée de sa présentation lors du webinaire « Construire des propositions pour l’économie féministe et pour la justice environnementale » organisé le 15 juillet 2025 par Les Amis de la Terre International, la Marche mondiale des femmes, Capire et la radio Mundo Real.