Elena Lora est une Dominicaine noire d’ascendance haïtienne. Assistante sociale, elle est cofondatrice du mouvement Reconocido [Reconnu], une organisation indépendante de défense des droits civiques composée principalement de jeunes. « Le travail de Reconocido consiste à revendiquer et à lutter pour les droits des personnes afrodescendantes nées sur le territoire dominicain, dont les droits civils et politiques fondamentaux ont été violés. Nous travaillons sur la question de l’autoreconnaissance contre la violation des droits des personnes nées ici en République dominicaine », explique Elena.
Reconocido a d’abord vu le jour sous la forme d’une campagne de dénonciation de violations des droits. Cette organisation est considérée comme la continuation du travail militant de la dirigeante Sonia Pierre, décédée en 2011, l’année même de sa création : « pour poursuivre la lutte qu’elle a menée de son vivant. »
Reconocido est présente dans presque tout le pays, en particulier dans les bateyes (camps de travailleurs), lieux construits autour de la production de canne à sucre, « puisque la plupart d’entre nous dans cette situation sommes fils et filles de mères et de pères haïtiens, et historiquement, la République dominicaine a maintenu une force bilatérale entre les États, qui avaient des contrats pour faire venir des travailleurs manuels haïtiens à partir de la fin du 19e siècle. La pratique consistant à faire venir des Haïtiens pour travailler comme ouvriers s’est poursuivie jusqu’en 1997 », explique Elena, avant de poursuivre : « De cette migration sont nés les enfants de ces migrant·es ».
Ce que le tourisme vend, c’est le développement de la République dominicaine. Mais au fond, en son sein, il y a toute une politique de discrimination basée sur les origines raciales, la couleur de la peau et les noms de famille
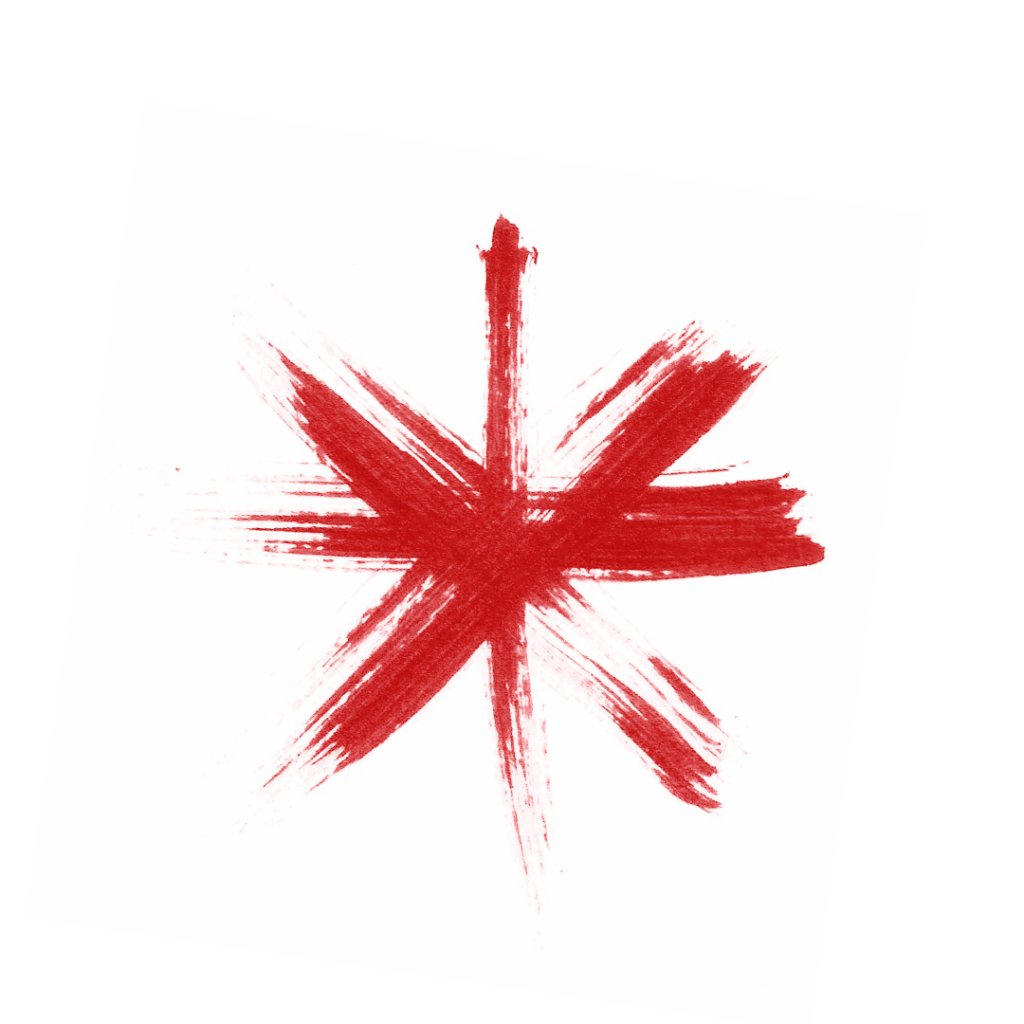
Quelle est la participation des femmes au sein de l’organisation ?
Le mouvement Reconocido est mixte, mais les leaders sont principalement des femmes. Nous sommes représentées dans la coordination nationale, dont la direction est composée de trois femmes. Les coordinations régionales sont également composées de femmes. En d’autres termes, les femmes ont une voix active dans les communautés où nous opérons. Nous comprenons que cela est important, étant donné que les questions autour de la politique de dénationalisation sont intimement liées aux questions de genre.
Si une migrante haïtienne ou descendante qui n’a pas encore de papiers a un enfant avec un Dominicain, même si ce dernier a des papiers, l’enfant ne peut pas être déclaré, car c’est la femme qui doit avoir des papiers. En ce sens, la situation devient encore plus grave lorsque ce sont les femmes qui vivent cette réalité de la dénationalisation, qui, comme une chaîne, affecte leurs fils et leurs filles.
Plus de 200 000 personnes sont actuellement considérées comme apatrides, mais il n’existe pas de statistiques désagrégées sur le nombre d’hommes et de femmes. Une étude comparative de l’enquête nationale sur les immigrants du pays indique qu’il y a 277 000 personnes descendantes de migrants haïtiens dans le pays, mais il n’y a pas non plus de données désagrégées sur les hommes et les femmes.
Compte tenu des politiques migratoires actuelles de déportation et d’insécurité, comment comprenez-vous les actions des forces conservatrices ? Y a-t-il une campagne anti-immigration en cours ?
Le mouvement est composé de personnes qui sont nées en République dominicaine et qui, pour la plupart, ne sont jamais allées en Haïti. Nous ne parlons même pas le créole. En ce sens, notre combat est celui de la nationalité et de la reconnaissance du droit de naître pour les personnes d’ascendance haïtienne. Nous sommes une conséquence de la migration haïtienne en République dominicaine. Nous ne sommes pas non plus exempts de toutes les politiques migratoires que le pays met actuellement en œuvre.
Il l existe des groupes qui se disent de la « société civile », mais qui, au final, sont soutenus par les mêmes forces de l’élite conservatrice du pays. Autrefois, il existait un secteur politique appelé la Force Nationale Progressiste, qui a toujours tenu un discours sur la question migratoire. Aujourd’hui, des groupes comme l’Ordre Ancien se sont levés contre la migration. Au cours des quatre dernières années, l’actuel président, Luis Abinader, a de plus en plus intégré cette question dans son agenda d’État et, à partir du pouvoir exécutif, il a mis en œuvre des mesures qui renforcent les violences faites aux droits des personnes, en particulier ceux des femmes.
En tant qu’organisation de défense des droits humains, nous dénonçons toutes ces discriminations et ces politiques racistes structurelles qui ont été mises en place et qui mettent également en danger nos vies en tant que jeunes né·es dans le pays. Pour les femmes, en termes de santé et de santé sexuelle et reproductive, il y a toute la question de la violence obstétrique, qui est devenue la norme. Dans les centres médicaux, ils arrêtent les femmes noires et descendantes, et les emmènent peu après leur césarienne. Ils portent atteinte à leur dignité. La crise migratoire est mondiale, mais en République dominicaine, nous vivons des situations particulièrement marquantes avec la population migrante haïtienne. La réalité que traverse Haïti est une crise historique, structurelle et humanitaire.
Comment voyez-vous les expressions actuelles du racisme en République dominicaine ?
Elles s’expriment dans les médias, dans les textes scolaires, dans les lois du pays. La décision 168.13 elle-même (qui dénationalise plus de 200 000 personnes) est basée sur le racisme institutionnel. Cette discrimination institutionnelle et structurelle existe depuis le massacre de 1937, lorsque le dictateur Rafael Leónidas Trujillo a commencé l’anti-haïtianisme.
Par ailleurs, le langage des médias et des groupes paramilitaires qui se sont dressés contre les migrants haïtiens et leurs descendants nous indique que la question du racisme est davantage structurelle et qu’elle a gagné en force. Il ne vient pas seulement de l’Etat, mais aussi des institutions, de la communication et des communautés. Ils les considèrent comme un fardeau, un fléau, des envahisseurs. Le racisme s’est aggravé, multipliant les discours de haine.
La politique migratoire mise en œuvre actuellement par le président Luis Abinader représente également un risque pour les personnes dominicaines d’origine haïtienne, car elle est basée sur le profilage racial. Une femme noire sans papiers est déportée, détenue ou expulsée vers un pays qu’elle ne connaît pas par les agents migratoires ou les forces autorisées à le faire.
Un exemple récent : en juin, une Dominicaine née ici a été expulsée. Des agents migratoires ont perquisitionné sa maison à la recherche de migrants et l’ont emmenée avec ses trois enfants. Elle a été soumise cette situation de dénationalisation. Elle a été envoyée en Haïti, mais elle n’a pas de famille là-bas. Ses trois enfants étaient malades. Malgré cela, l’Etat n’a fait aucun commentaire pendant des semaines. Elle n’est pas haïtienne, mais l’Etat dit qu’elle l’est. Lorsqu’elle est arrivée en Haïti, elle n’avait nulle part où aller parce qu’elle n’a pas de famille, pas de racines, rien. Cela est lié à la politique migratoire et au racisme. Tout cela est basé sur la discrimination raciale. Pourquoi l’ont-ils emmenée ? Parce qu’elle est noire.
Selon vous, à quoi devrait ressembler une politique pour le droit d’exister et de vivre dignement dans le pays où l’on est né ou là où l’on est allé vivre ? Quel est le rôle des mouvements populaires dans cette construction ?
Je pense que l’une des solutions consiste à se rappeler que la République dominicaine est un État social, démocratique et de droits. Or, elle viole sa propre Constitution. Une façon de résoudre tout cela est de reconnaître cette violation comme telle et de garantir la dignité de toutes les personnes, indépendamment de leur origine, de leur race ou de leur genre.
Les États doivent adopter une politique plus inclusive sur la question de la nationalité. L’État doit restituer pleinement la nationalité à toutes les personnes dominicaines. Cela nous permettra d’aller de l’avant, de jouir de nos droits civils et politiques et de constituer la citoyenneté qui nous appartient. Pour la population migrante haïtienne, l’État doit garantir et reconnaître que le fait d’être migrant·e ne constitue pas un crime et que cette population, envers laquelle il a une dette historique, contribue de manière significative à l’économie de la République dominicaine.
Au lieu de dépenser autant d’argent dans la militarisation des zones frontalières, dans des processus qui augmentent souvent la traite des êtres humains et bafouent les droits des personnes migrantes, il serait préférable de conclure des accords bilatéraux, de développer ces zones et de donner aux migrant·es qui se trouvent dans ces régions voisines la possibilité de travailler.
Il faut une réglementation complète qui tienne compte des travailleur·ses, des leurs enfants et des personnes qui sont historiquement présentes dans le pays. Ceux que l’on appelle les « vieux coupeurs de canne à sucre », par exemple, sont arrivés, ont consacré leur vie, ont travaillé, ont cotisé et aujourd’hui, l’État n’est pas en mesure de leur fournir une pension qui leur garantisse une vieillesse digne. Beaucoup meurent dans la pauvreté et l’exclusion. Leurs enfants non plus n’ont pas de droits et vivent dans une situation de dénationalisation et d’apatridie. L’apatridie en République dominicaine est la plus élevée de l’hémisphère occidental.
Nous devons faire pression et nous battre pour que nos voix soient entendues. Nous ne voulons pas être réduit·es au silence, mais nous voulons pouvoir continuer à construire sur la base de notre expérience et de notre travail avec les populations vulnérables. Les personnes haïtiennes sont des personnes et, en tant que telles, ne doivent pas être considérées comme des nuisibles. Ce sont des personnes qui apporteront leur contribution. La population dominicaine d’origine haïtienne est victime de discrimination. Ce sont des personnes en situation de mort civile, et cela doit être porté à la connaissance du public afin que tout le monde en soit informé.




